

Sciences humaines et sociales > Accueil > Technologie et innovation > Numéro
Les bio-intrants constituent l’une des principales innovations agricoles face à la crise associée à l’utilisation de produits chimiques. Les micro-organismes appliqués à la nutrition des plantes et au contrôle des ravageurs apparaissent comme des technologies clés dans la transition vers une agriculture durable. Toutefois, leur développement ne dépend pas uniquement d’aspects techniques, mais aussi du système de réglementations qui les institutionnalise. Cet article présente les avancées d’une recherche exploratoire sur la production de bio-intrants en Argentine et leurs formes d’institutionnalisation. Il analyse le contexte d’émergence de ces innovations, les acteurs impliqués et le système de réglementations et de politiques publiques qui encadrent, promeuvent ou limitent leur développement. Sur le plan méthodologique, l’étude combine une analyse documentaire avec des données secondaires et quantitatives issues de sources officielles, ainsi que des entretiens approfondis et une observation participante. Les résultats montrent que, bien que les bio-intrants constituent une technologie implantée dans le pays et appuyée par une structure industrielle incluant des entreprises locales, leur institutionnalisation reste marquée par des contradictions, ce qui conditionne les possibilités de consolidation de ces intrants.
Face aux conséquences néfastes de l’usage intensif des pesticides chimiques, les biopesticides émergent progressivement comme une solution prometteuse pour la gestion des stress biotiques en agriculture. Cet article dresse un panorama global de l’usage des pesticides et de l’essor des biopesticides, avec une attention particulière portée au contexte africain. L’analyse de données récentes révèle de fortes disparités régionales : les Amériques, l’Europe et certaines régions d’Asie dominent à la fois en termes de volumes de pesticides consommés et de nombre de produits de biocontrôle enregistrés. En revanche, l’Afrique se caractérise par une utilisation relativement faible de pesticides chimiques, avec une moyenne de seulement 0,7 kg/ha en 2023. Parallèlement, plusieurs pays africains enregistrent des avancées notables en matière de biocontrôle. L’article examine les principaux déterminants de ces dynamiques et identifie les leviers à mobiliser pour favoriser le développement du biocontrôle sur le continent.
À Cuba, afin de garantir la production porcine dans des systèmes intensifs à grande échelle, des alternatives efficaces et sûres pour les consommateurs et l’environnement sont recherchées. Les prébiotiques et les probiotiques comptent parmi les options les plus répandues et les plus inoffensives. L’objectif de cette recherche est de contribuer, par un processus d’innovation technologique, à l’introduction d’une technologie de micro-organismes efficaces (ME) en élevage porcin au sein de la PME Carnes D’Tres. Différents ME produits dans et hors de la province de Ciego de Ávila ont été évalués d’un point de vue technique, économique et logistique, ainsi que leur effet comme additif alimentaire dans l’alimentation des porcs d’engraissement. Selon l’étude de faisabilité technique, économique et logistique, il est moins coûteux, plus pratique et plus sûr d’acheter les ME RH-Vigía en phase solide et de fabriquer les phases liquide et stabilisée sur place que d’acheter tout autre ME en phase liquide stabilisée. L’ajout de ME à l’alimentation des porcs a également eu un effet positif, notamment durant les premières semaines d’engraissement, réduisant la morbidité, augmentant le poids vif du lot et réduisant les coûts alimentaires par unité de gain de poids, par rapport aux animaux dont l’alimentation ne comprenait pas le bioproduit.
L’article présente l’outil LOTUS, développé par le laboratoire RASSCAS de l’ISEN Méditerranée, pour évaluer les impacts sociaux et environnementaux des projets technologiques. LOTUS est un atelier de 3 heures qui vise à concevoir des solutions pour réduire ces impacts. L’outil s’appuie sur les travaux de Kate Raworth et du Stockholm Resilience Centre. Les expérimentations ont montré que LOTUS a dépassé les objectifs initiaux, favorisant l’acceptabilité des projets et la prise en compte des limites planétaires et des besoins sociaux. L’outil est polyvalent et adaptable à différents types de projets. Les résultats soulignent l’importance de prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux dans les projets technologiques. LOTUS représente une avancée significative dans la conception responsable et durable des technologies, et ouvre des perspectives de développement futur pour une conception plus régénérative.
Cet article propose une analyse critique des usages du concept d’innovation dans le secteur naval de défense français. S’appuyant sur une enquête qualitative menée auprès d’ingénieurs, de marins et de décideurs institutionnels, il met au jour l’ambivalence du terme : à la fois outil de légitimation institutionnelle et catégorie performative orientant l’action. L’innovation s’inscrit ici dans des logiques de pouvoir, révélant une fracture entre les innovations « descendantes », portées par l’État et l’industrie, et les innovations « ascendantes », issues du terrain. En filigrane, deux visions s’opposent : l’une valorise la rupture technologique, la complexité et la projection à long terme ; l’autre défend l’adaptabilité, la simplicité et la maîtrise concrète des équipements. Cette tension redéfinit les compétences, les rôles et les hiérarchies professionnelles, tout en posant une question centrale : qui détient, en pratique, le pouvoir d’innover dans la Marine ? Certes, l’innovation ouverte promeut la participation de tous, mais quelle place réelle les apports des opérationnels occupent-ils dans les grandes orientations stratégiques ? Loin d’être un concept neutre, l’innovation apparaît ici comme un analyseur du politique, structurant les rapports entre élites institutionnelles et acteurs de terrain. L’analyse met en lumière un sentiment de dépossession progressive des savoir-faire opérationnels au profit d’acteurs centraux détenant les ressources pour imaginer le futur. L’innovation devient ainsi un levier de redistribution du pouvoir symbolique dans la fabrique du changement.
Dans des environnements turbulents et incertains, les organisations recourent de plus en plus à des structures temporaires pour renforcer leur capacité d’adaptation. Cette étude analyse le rôle des task forces dans la supply chain aéronautique pour le développement des microfondations des capacités dynamiques. À partir d’observations participantes et d’entretiens auprès d’acteurs du secteur, nous montrons comment les task forces, conçues à l’origine comme outils de gestion de crise, évoluent vers des mécanismes adaptatifs favorisant la réactivité, la collaboration et la flexibilité stratégique. Nos résultats soulignent qu’elles peuvent catalyser l’apprentissage et la coordination tout en redéfinissant leur caractère temporaire.
Aujourd’hui le système de santé français est confronté à un double défi : le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques, qui mettent en tension un modèle historiquement centré sur l’hôpital et le curatif. Les stratégies non-médicamenteuses (SNM) apparaissent comme une réponse innovante et nécessaire, en renforçant la prévention, en améliorant la qualité de vie et en réduisant la consommation de médicaments. Issues du modèle biopsychosocial, elles englobent des actions variées qui requièrent une participation active du patient et une coordination interprofessionnelle. Leur intégration dans les politiques publiques récentes illustre une volonté de promouvoir une santé plus intégrative et personnalisée. Toutefois, leur essor doit s’accompagner de garde-fous éthiques et scientifiques afin d’éviter les dérives. Les SNM s’imposent ainsi comme des leviers essentiels d’une médecine préventive et durable, capable de répondre aux grands enjeux sanitaires et sociétaux actuels.
Les coordonnées géographiques de Latitude et de Longitude fournies par Google Earth sont affectées par des erreurs qui laissent affirmer des incertitudes dans les mesures des distances et des trajets. La présente étude propose des formules d’amélioration afin de rendre les données de géolocalisation plus précises. Dans une démarche qui présente les formules pour évaluer et améliorer les incertitudes sur les distances produites par Google Earth, nos résultats démontrent que les incertitudes et les erreurs sur les distances contenues dans les mesures provenant de Google Earth sont tangibles en fonction de l’évaluation des distances qu’elles soient courtes, longues ou moyennes. La probabilité d’erreurs sur les coordonnées fournies par Google Earth est de plus ou moins (+/-) 2 mètres. La distribution des erreurs en fonction des distances montre qu’une erreur de +/- 3 m a seulement 0,4% de chance d’être dépassée. Cette méthodologie prend en compte la structure du globe terrestre : les méridiens, les parallèles, les pôles, l’équateur, les hémisphères et la structure bosselée de la Terre. Ces corrections contribuent à corriger la précision dans les applications qui utilisent la géolocalisation comme moyen d’optimisation des services. La correction des erreurs issues des coordonnées géographiques en se servant des formules qui réduisent les erreurs auraient un impact sur la géolocalisation dans les secteurs d’activités tels que le transport des biens, l’agriculture de précision et la santé. Tout en tenant compte du fait que la géolocalisation offre des avantages considérables en transformant de nombreux domaines, elle pose cependant quelques questions importantes concernant la vie privée des individus.
Contrairement à une opinion répandue, l’amélioration de la situation écologique n’implique pas nécessairement la diminution du PIB. Il convient d’abord de réévaluer l’importance des valeurs d’usage gratuites de la nature, et de construire un Indicateur de Conditions de Vie qui prenne en compte ces valeurs d’usage. Ensuite, un programme économique de long terme (2026-2050) est proposé, qui permet une reconversion écologique associée à une amélioration des conditions de vie de la population (en particulier la réduction de la durée du travail). Il repose sur une augmentation forte de la productivité du travail, favorisée par un fort investissement, couplée à une croissance économique modérée et à une réduction drastique des inégalités de toutes sortes.
Cet article analyse l’essor de l’investissement à impact (II) depuis les années 2010, présenté comme une voie pour concilier performance financière et transformation sociale et environnementale. Fondé sur les principes d’intentionnalité, d’additionnalité et de mesurabilité, l’II se développe dans un champ marqué par des tensions entre rentabilité et finalités extra-financières, standardisation et contextualisation, ambition transformative et risques de dérive (greenwashing, mission drift). L’étude montre que les instruments de mesure d’impact jouent un rôle performatif : ils ne se contentent pas d’évaluer, mais orientent les priorités et l’allocation des capitaux. Toutefois, cette financiarisation des biens communs et du vivant soulève des enjeux éthiques et politiques majeurs. L’article insiste ainsi sur la nécessité d’une gouvernance inclusive intégrant les parties prenantes vulnérables et sur un ancrage contextuel des métriques. En conclusion, l’investissement à impact ne pourra réaliser sa promesse transformative que s’il reconfigure ses instruments, sa gouvernance et ses cadres d’évaluation, pour favoriser une transition juste, solidaire et démocratique plutôt que de s’aligner sur les logiques dominantes de la finance.
De plus en plus d’organisations publiques mettent en oeuvre des démarches participatives telles que la co-création pour renforcer le lien avec la population et concevoir des politiques publiques adaptées à ses besoins. Cependant, certains publics restent systématiquement absents de ces processus. Dans un premier temps, cet article propose quatre dimensions analytiques pour caractériser la co-création de politiques publiques et évaluer son ampleur d’une démarche à l’autre. Il examine ensuite la notion de non-participation et en analyse les déterminants. Enfin, cinq approches identifiées dans la littérature sont présentées comme susceptibles d’accroître l’inclusivité des démarches : l’« aller-vers », les incitations, les dispositifs numériques, la mobilisation d’ambassadeurs et le développement de compétences. S’adressant tant aux chercheurs qu’aux praticiens, l’article fournit ainsi des pistes concrètes pour mobiliser les publics habituellement « invisibles » et repenser l’inclusivité de la co-création.
Les plantes présentes dans l’environnement sont confrontées à des stress constants, qu’ils soient biotiques ou abiotiques. Ces stress peuvent réduire considérablement la productivité de cultures importantes dans le monde entier, avec des pertes annuelles de rendement allant de 25 % à 50 % de la production totale. Les stress biotiques comprennent les herbivores, les ravageurs et les agents pathogènes. Les plantes ont donc développé un système de défense multicouche pour prévenir le problème du stress biotique, qui comprend le système de défense constitutif (SAR) et le système de défense induit (ISR). L’utilisation excessive de produits chimiques synthétiques a des effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine, ce qui décourage l’application de pesticides dans le secteur agricole. En conséquence, les chercheurs du monde entier se sont tournés vers des stratégies alternatives respectueuses de l’environnement pour prévenir les maladies des plantes. Il existe toute une gamme d’agents de lutte biologique. Actuellement, les chercheurs explorent l’utilisation de micro-organismes bénéfiques comme stratégie écologique pour lutter contre les maladies des cultures. Divers genres de bactéries et de champignons ont démontré un grand potentiel en tant qu’agents de lutte biologique contre diverses maladies des plantes. En outre, à ce jour, les chercheurs en biotechnologie explorent la résistance systémique acquise (SAR) et la résistance systémique induite (ISR) des plantes, leur rôle et leur mode d’action contre les phytopathogènes et le stress des plantes. Cet article s’efforce de décrire les nouveaux biostimulants et éliciteurs naturels créés par la biotechnologie et la nanotechnologie au cours des dernières années, afin d’apporter un nouvel éclairage sur l’augmentation de la SAR et de l’ISR dans le système de défense des plantes.
Cette recherche présente une plateforme numérique innovante qui combine le modèle haïtien du kolòn avec la théorie des communautés de pratique pour soutenir la co-conception de projets et l’apprentissage collaboratif dans les espaces de fabrication. Basée sur une étude impliquant 57 participants et cinq communautés internationales de makers, cette plateforme a été conçue pour faciliter l’apprentissage par les pairs et le développement des compétences grâce à un système de mentorat distribué. Nos résultats montrent des améliorations significatives des capacités de collaboration et des taux de réussite des projets. Ils mettent en évidence le processus de co-création d’une solution technologique centrée sur une approche communautaire, collaborative et inclusive. Ce travail contribue à faire progresser l’innovation et le développement des compétences dans le domaine de la fabrication numérique en fournissant un cadre pour « apprendre en fabriquant ensemble » qui fait le lien entre les espaces de fabrication virtuels et physiques.
L’article présente la définition des protocoles personnalisés et ciblés de prévention et de soin fondés sur la science, les interventions non médicamenteuses (INM), proposée par une société savante internationale pluridisciplinaire consacrée au sujet, la Non-Pharmacological Intervention Society. Il précise le périmètre de ces solutions de santé à partir d’un cadre éthique et scientifique d’évaluation standardisé co-construit en deux années avec plus de 1000 personnes. Ce cadre permet depuis 2024 la constitution d’un patrimoine universel de protocoles immatériels de prévention et de soin au sein d’une bibliothèque numérique appelée le Référentiel des INM.
La Pleine conscience en tant qu’Intervention Non Médicamenteuse (INM) s’inscrit en complémentarité de la médecine conventionnelle dans une santé intégrative, étant à la fois protocole de soin et protocole de prévention. Elle permet d’aborder la personne dans son entièreté et non plus seulement en tant que patient au regard de sa seule maladie. Les établissements de santé sont aujourd’hui nombreux à la déployer en soins de support, pour les cas de maladies et douleurs chroniques ; et pour son impact sur l’efficience des organisations et le sens donné au prendre soin. Depuis quelques années, la Pleine conscience est aussi intégrée aux formations traitant du développement du leadership dans les organisations. Son déploiement dans la filière santé constitue donc un enjeu majeur et cet article détaille les impacts attendus à ces dispositions.
La Malaisie offre une large variété de médecines traditionnelles provenant de sa riche ethnicité, auxquelles se sont progressivement rajoutées des médecines complémentaires plus ou moins mondialisées. La pratique de ces médecines, largement composées de thérapies manuelles, est pertinente pour investiguer leur fonction de substitution aux interventions médicamenteuses. Cet article aborde cette question en montrant que le modèle thérapeutique proposé par Malaysian Holistic and Herbal Organisation, repose sur une subtile combinaison de pratiques non médicamenteuses issues de médecines T&C, et prend en compte les divers aspects de la maladie et du patient et favorise la démédicalisation. Inversement, le modèle intégratif développé par le gouvernement, trop réducteur par sa forme, ne permet de pallier que partiellement la forte médicalisation intrinsèque à la biomédecine.
L’action du « prendre soin » est un des plus vieux gestes réalisés envers autrui. Au-delà de la santé et du bien-être, il convient d’élargir le champ de ces pratiques aux diverses dimensions du soin dans l’idée même d’appréhender, dans ses unités et ses diversités, une variation de situations passant des actes les plus. Ponctuels aux enjeux éthiques, politique et prospectifs les plus vastes. Ainsi la mise en pratique de stratégies de soins non-médicamenteuses permet de questionner et de se demander comment les savoirs et pratiques du « prendre soin » peuvent être réinterrogés dans un monde pluriculturel. Pour ce faire, il s’agit d’étudier les conditions d’application de ces stratégies afin que celles-ci deviennent des compétences clés pour un monde plus durable et solidaire.
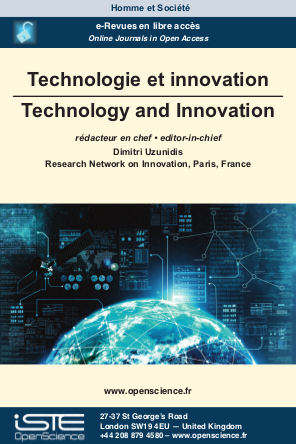
2026
Volume 26- 11
Les possibles de la décarbonation de l’industrie : au-delà du progrès technique2025
Volume 25- 10
La décarbonation : industrie, économie et politique2024
Volume 24- 9
Les filières de production dans la bioéconomie2023
Volume 23- 8
Intelligence artificielle et Cybersécurité2022
Volume 22- 7
Trajectoires d’innovations et d’innovateurs2021
Volume 21- 6
L’innovation collaborative2020
Volume 20- 5
Les systèmes produit-service2019
Volume 19- 4
L’innovation agile2018
Volume 18- 3
Innovations citoyennes2017
Volume 17- 2
Innovations de mobilité. Transports, gestion des flux et territoires2016
Volume 16- 1
Stimulateurs de l’entrepreneuriat innovant