

Sciences humaines et sociales > Accueil > Technologie et innovation > Numéro
Dans la lumière des apports des logiques de l’Intelligence Artificielle (l’IA) et des problématiques de recherche sur les solutions de qualification participative des données d’impact rappelant des interrogations et analyses plus anciennes dont le paradoxe de Condorcet [CON 85] et la théorème de l’incomplétude d’Arrow [ARR 51] ou du Prix Nobel Amartya Sen [SEN 70] sur les évolutions des modèles économiques vers une économie du bien-être avec le choix collectif nous proposons des réponses possibles de co-construction des nouveaux outils et processus hautement collaboratifs de qualification ouverte [PAU 12]. En prenant en compte la diversité des acteurs de l’innovation ouverte pour intégrer les capabilités augmentées par l’IA nous arrivons à intégrer ex ante dans les processus hautement démocratiques et des outils IA la diversité des déterminants évolutifs des avis sur les impacts perçus sur tout sujets d’intérêt commun exprimés. Cela conduit nos recherches vers la découverte [PAU 22] d’une troisième typologie d’IA en plus de celle symbolique et celle connexionniste-connective : l’Intelligence Qualificative (QuAI) - avec la capabilité d’intégrer l’esprit critique humain. Les nouveaux espaces – les outils QuAI, les processus de qualification ouverte collaboratifs - peuvent ainsi mener à des choix optimaux par la collaboration et la création collective de pertinence et confiance notamment par les nouvelles capabilités dynamiques créatrices potentielles d’innovations disruptives. Plusieurs fonctionnalités d’usages sont identifiées en termes d’évolutions vers une économie de la fonctionnalité [VAI, 20]. et la démocratisation de l’accès et de la contribution aux données d’impacts visant des solutions et outils innovants disruptifs de résilience [SCH 22] face aux crises multiformes : économiques, climatiques, de confiance [PAU 09, 12, 18], [ADA, 18].
L’importance stratégique de l’information dans la compétitivité d’un pays et la gestion d’entreprise. Dans la société du savoir, l’information économique, qui diffère des autres biens, est cruciale pour l’avantage concurrentiel. Les entreprises qui accèdent aux informations pertinentes (marchés, juridiques, technologiques, etc.) avant les autres peuvent prendre des décisions stratégiques plus éclairées. Avec l’augmentation massive des données disponibles, l’intelligence économique devient essentielle pour filtrer et organiser ces informations. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les processus d’entreprise nécessite une approche méthodique, incluant le développement de solutions d’IA personnalisées, leur intégration avec les systèmes existants, et leur utilisation pour améliorer ou créer des services innovants qui améliorent l’expérience client.
La pratique professionnelle ou semi-professionnelle des wargames est appelée wargaming. Elle comprend de nombreuses formes de simulations de guerre qui ont en commun d’être des jeux sérieux fondés sur des données issues du terrain et/ou visant à en collecter de nouvelles. Leur usage peut être à visée pédagogique, préparatoire à la mise en oeuvre d’un plan, exploratoire ou prospectiviste. Le wargame se joue sur un support physique ou informatique, voire via une forme hybride entre ces deux alternatives. À partir d’un parcours de la littérature consacrée à ce sujet, cet article propose d’éclairer le lecteur sur les différentes catégories de wargames pratiquées par les militaires, ainsi que sur les avantages, inconvénients et risques d’emplois de wargames physiques vis-à-vis des numériques.
Le programme Red Team Défense de l’armée française consiste à créer des récits de science-fiction dans le but d’anticiper les conflits qui pourraient menacer le territoire à horizon 2030-2060. S’inscrivant dans le courant de la science-fiction institutionnelle, il repose sur la capacité à susciter l’estrangement cognitif cher à Darko Suvin et à créer des novums (technologies imaginaires) vecteurs de difficultés, mais aussi de solutions aux problèmes recontrés dans les guerres du futur. Si certains novums ont une fonction performative, la diégèse, c’est-à-dire l’environnement spatiotemporel du récit, revêt davantage une dimension dysperformative. Ces histoires cherchent à susciter la réaction des militaires face à des dangers imaginaires afin qu’ils mettent en oeuvre en amont des stratégies permettant d’éviter leur réalisation. Les auteurs de science-fiction captent l’inconscient des organisations et révèlent leurs imaginaires prophétiques. L’innovisme est par ailleurs une véritable idéologie utilisant pragmatiquement l’imaginaire pour remettre en question l’ordre établi et générer de nouvelles idées sources de destruction créatrice. La Red Team fait par ailleurs entrer l’armée française dans un régime d’historicité orienté vers le futur, plus que vers les batailles du passé. La science-fiction est aussi un genre paradoxal, impliquant une interprétation spécifique du réel et de l’avenir. Il convient donc de s’interroger sur les avantages et éventuels désagréments liés à l’utilisation d’une vision paradoxale du futur dans l’élaboration des stratégies d’une organisation visant avant tout l’efficacité et le pragmatisme.
En raison des récentes pandémies, la majorité des organisations ont dû expérimenter le travail à distance à des degrés divers et ont reconnu la productivité exceptionnelle des salariés dans ces conditions particulières. Malgré ce bilan positif, et en dépit des aspirations des salariés, les entreprises les plus innovantes plaident de manière autoritaire pour un retour à plus de présentiel, car il serait le seul mode d‟organisation du travail à même de produire la collaboration nécessaire à l‟efficacité des équipes innovantes. Dans cet article, nous montrons que cet argument du retour au bureau se base sur une conception étroite qui fait de la confiance produite par le présentiel, ou confiance affective, le principal moteur de la dynamique collaborative. En s‟appuyant sur les Trust Studies et des travaux en management de l‟innovation, nous soulignons, au contraire, que la distance ne limite pas la production d‟une confiance efficace et adaptée aux exigences des équipes innovantes. Nous allons même plus loin en proposant une articulation inédite entre deux formes de confiance, la swift trust et la confiance réflexive, à travers une confiance réflexive rapide, pour soutenir un nouveau mode de travail hybride favorisant la collaboration et l‟innovation.
Le développement du numérique est mis en avant comme solution aux enjeux économiques et environnementaux de l’agriculture, alors que ses effets font l’objet de controverses. Cet article cherche à montrer comment le développement du numérique dans le secteur agricole impacte et s’intègre dans les différents modèles agricoles. Pour cela, il propose une approche en économie institutionnelle et multi-niveaux des systèmes d’innovation, mise en oeuvre à travers une méthodologie associant analyses quantitatives et qualitatives. À l’échelle des organisations du système d’innovation agricole, selon que les acteurs se rattachent à l’agriculture biologique ou conventionnelle, les attentes et risques perçus, ainsi que les stratégies de digitalisation, sont différents. Ces différences sont toutefois peu perçues par les acteurs du numérique. A l’échelle des exploitations agricoles, à partir de 98 entretiens avec des agriculteurs, des profils d’usage du numérique sont construits. Dans l’ensemble, les usages du numérique dans les exploitations accompagnent plutôt des stratégies d’écologisation faible, ou symbolique, associées à une trajectoire d’industrialisation, caractérisée par la spécialisation, la concentration, le recours croissant au salariat et à la sous-traitance et l’intégration dans les chaînes de valeur agrialimentaires. Ce travail met en évidence que les perceptions et usages du numérique diffèrent selon les modèles agricoles auxquels les acteurs se rattachent. La digitalisation n’apparaît pas comme la résultante de comportements dits « pionniers » mais dépend de la diversité des modèles et paradigmes, en interaction avec un système socioéconomique qui propose, incite, voire impose ces technologies. La digitalisation actuelle montre plusieurs formes d’oppositions vis-à-vis de la transition agroécologique, que ce soit en termes techniques, d’objectif, de raisonnement, de dynamique temporelle mais aussi d’enjeux politiques et sociaux. Des hybridations semblent toutefois possibles dans le cas de formes d’écologisation industrielle, mais aussi à travers une transformation plus globale de la digitalisation elle-même en repensant ses modèles techniques, économiques et politiques.
The global decline in resources and raw materials, challenges in waste management, and the rise in greenhouse gas concentrations are driving companies to seek more sustainable and symbiotic business models. Digital platforms, as hubs for information and data flows, play a key role in coordinating symbiotic production and service systems. Industrial symbiosis (IS) represents one such business model, where the exchange of waste, by-products, or other resources between firms and local organizations generates new forms of competitive advantage. Despite growing awareness of the role of information technologies and digital platforms in advancing sustainability, research on these digital sharing platforms as enablers of symbiotic networks remains in its early stages. This paper seeks to address this gap by examining the role of digital platforms in transitioning local ecosystems into symbiotic and “smart” communities. The study employs a systematic review of existing literature alongside a case study. The paper is structured into three major sections, followed by conclusions and implication.
Cet article fait état du travail de recherche conduit au cours de mon doctorat « La couleur dans l’environnement visuel : perception(s), lecture(s), interprétation(s) et impact(s) sur l’usager âgé. De l’approche de l’ingénieur lumière (science et technologies des systèmes d’éclairage) et du designer-coloriste (arts-appliqués, design) ». Partant du postulat que maintenir la capacité des personnes âgées à conduire leurs activités quotidiennes est un levier majeur pour prendre soin de leur qualité de vie, j’ai développé une nouvelle méthode conception combinant design-couleur et science de l’éclairage, dessinant les prémices d’une stratégie non-médicamenteuse conduisant à la conception d’environnement adaptés aux besoins de l’usager âgé présentant des troubles visuels, dans un premier temps. Cette démarche systémique est ainsi moteur d’une innovation sociale en rupture avec les modalités actuelles du prendre soin.
La Covid-19 a montré les défaillances des systèmes de santé (à travers le manque de dispositifs médicaux) mais également de nouvelles façons d’innover, en particulier via l’innovation ouverte. Une étude de cas exploratoire illustrant l’intérêt de l’innovation ouverte dans le cadre pandémique seront développées. La question de recherche est : comment l’innovation ouverte a-t-elle stimulé la production de soins pour faire face à la pandémie ? L’étude de cas de l’alliance pharmaceutique Pfizer/BioNTech s’appuie méthodologiquement sur le référencement complet et l’analyse systématique des publications, documents scientifiques relatifs à l’innovation ouverte. Suivant ce travail, nous serons en mesure de montrer que dans le contexte pandémique, l’innovation ouverte est un vecteur efficace pour élargir les partenariats afin d’accélérer les activités de R&D et de production.
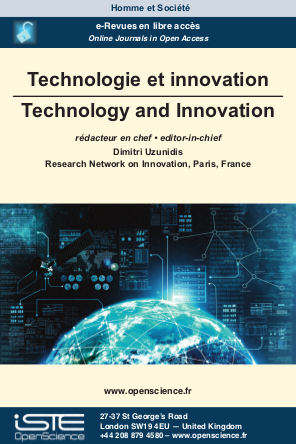
2026
Volume 26- 11
Les possibles de la décarbonation de l’industrie : au-delà du progrès technique2025
Volume 25- 10
La décarbonation : industrie, économie et politique2024
Volume 24- 9
Les filières de production dans la bioéconomie2023
Volume 23- 8
Intelligence artificielle et Cybersécurité2022
Volume 22- 7
Trajectoires d’innovations et d’innovateurs2021
Volume 21- 6
L’innovation collaborative2020
Volume 20- 5
Les systèmes produit-service2019
Volume 19- 4
L’innovation agile2018
Volume 18- 3
Innovations citoyennes2017
Volume 17- 2
Innovations de mobilité. Transports, gestion des flux et territoires2016
Volume 16- 1
Stimulateurs de l’entrepreneuriat innovant