

Sciences humaines et sociales > Accueil > Technologie et innovation > Numéro
For several decades, exponential growth in the use of fossil carbon has created drastic climate disturbances. To mitigate climate change, all uses of virgin fossil carbon must, urgently, be phased out. Many transport sources and industrial processes can easily be electrified and should be where possible. But some sectors like chemical, materials (e.g. lime and steel), aviation and maritime transport will continue to use carbon and the virgin fossil used today will need to be substituted to meet climate neutrality targets. Using CO2 to replace fossil carbon in sectors that will still need hydrocarbons is a key solution to « defossilise » our economy. The concept of Carbon Capture and Utilisation (CCU) is a broad term that covers processes that capture CO2 from flue and process gases or directly from the air and convert it into a variety of products such as fuels, chemicals, and materials. No precise global estimate of the potential mitigation role of CCU technologies exists to date, because of uncertainties in renewable electricity cost scenarios and the low granularity of models that simulate different CCU options. However, CCU technologies have the potential to play a significant role in the mitigation of climate change as described in the latest report of the Working Group 3 of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Ce chapitre vise à présenter un ensemble de vocables et concepts : « Ludopédagogie », « Jeux Sérieux », « Gamification », « Ludification », « Ludicisation », « Jouet Sérieux », « Serious Game », « Serious Gaming », « Dégamification » et « Toyification ». Ils sont tous en lien avec la « ludopédagogie ». Pour contextualiser nos propos, nous prendrons pour support un artefact, à savoir une éponge. Cette démarche vise à montrer comment un simple artefact peut être instrumentalisé pour tour à tour faire découvrir différentes notions en lien avec le jeu et des applications à visées utilitaires. Nous verrons par une telle démarche que les constructions sociales et la subjectivité des individus sont à l’oeuvre pour appréhender tous ces termes.
Cet article aborde la question de la décarbonation en témoignant de la démarche suivie depuis une quarantaine d’année, en particulier dans la sidérurgie : une longue trajectoire, traversée de crises et de périodes d’intense créativité, qui semble maintenant se traduire en actes industriels, même si la vrai "zéro net" ne sera atteint qu’en 2050, si la démarche en cours ne rencontre pas trop d’obstacles. On s’interroge aussi sur le rôle respectif des grandes organisations, comme les états ou l’AIE, et celui des individus : les rôles des deux types d’acteurs sont intimement intriqués. On rappelle aussi que décarbonation doit aller de pair avec la préservation de la biodiversité ou la maîtrise de la pollution de l’air, mais aussi avec des questions plus sociétales et politiques comme les migrations et les inégalités. Enfin, on propose de prendre en compte l’agentivité de tous les êtres vivants et des objets inanimés pour aborder ces questions dans toute leur complexité.
Nous prêtons rarement attention à la couleur dans ses fonctions et ses utilisations. Pourtant cette dernière entoure notre quotidien et renseigne sur l’histoire, la culture, la technique ou la santé des individus tout autant que de leurs environnements. Le design au service de la couleur, la couleur au service du design, le design-couleur engendre, c’est-à-dire invente et conçoit des projets et des produits tournées vers les « justes » besoins des hommes et des femmes. Sous la forme d’une introduction au design futur et à ses couleurs responsables ; à travers un panorama de démarches collaborées ; de recherches menées au sein d’ateliers-laboratoires et de bureaux d’études ; par le biais d’une analyse des tendances sociétales futures, le présent texte tente de formuler les enjeux, conceptions, représentations et postures d’un design-couleur biosourcé, entre arts et sciences, territoires et patrimoines humains et économiques, mode et beauté, alimentation et prendre soin, comme des alternatives méthodologiques et des méthodes de production prochaines faisant face aux imaginaires marchands promus par les modèles de conceptions actuelles.
Ce papier porte sur le procédé biotechnologique développé par l’entreprise PILI©, la synthèse enzymatique à partir de carbone renouvelable pour la production de molécules colorantes. Ce procédé innovant permet la production de colorants biosourcés, visant la réduction de l’empreinte environnementale de l’industrie de la couleur. Reposant sur les biotechnologies et des procédés hybrides alliant fermentation industrielle et chimie verte, l’entreprise produit aujourd’hui des gammes de couleurs performantes dédiées aux applications les plus polluantes : textiles, encres, polymères, peintures et revêtements. L’étude repose sur une revue de la littérature qui a permis d’établir un diagnostic des dernières innovation dans l’industrie textile française et la production de colorants biosourcés, identifiant ainsi le procédé développé par l’entreprise PILI© et de déterminer les freins, leviers et perspectives applicatives du procédé développé.
La thématique des couleurs biosourcées se trouve aujourd’hui au coeur de nombreux enjeux, notamment liés à des pratiques dites « alternatives ». Pami elles, la teinture naturelle offre de nombreuses possibilités. Il est ici principalement question du cas des lichens, petits êtres symbiotiques possédant un étonnant pouvoir colorant. Ambivalents, ils sont en effet employés au coeur d’usages traditionnels mais sont également très propices à l’expérimentation, menant ainsi à de nouvelles possibilités créatives. Au-delà d’une matière à coloration, le lichen devient ainsi matière à inspiration, notamment dans le domaine de la création textile. Une étude d’un exemple de processus tinctorial détaille les différentes étapes depuis le jardin jusqu’à la cuisine, mettant ainsi en lumière l’importance du cheminement. Enfin, une mise en pratique autour de l’association de deux matières colorantes (le lichen Evernia Prunastri et les oignons jaunes), illustre quelques possibilités d’exploration, soulignant la diversité des paramètres pouvant faire évoluer les palettes colorées ainsi élaborées.
L’analyse commence à partir de l’exploration d’un terrain réalisée sur un site girondin touché par les incendies à l’été 2022. Du territoire accidenté ressort des matières transformées source d’exploration de couleurs et de matières dans le cadre d’une pratique de la céramique. Comment la pratique de la céramique vient-elle révéler les singularités chromatiques de ces composants pour les penser comme des couleurs dites biosourcées ? De la collecte, à la technique vers la valorisation de matières territoriales, l’enjeu est de reconnaître une couleur comme attachée à une localité et un patrimoine en fabriquant la couleur à partir de ressources naturelles et/ou recyclables.
Il persiste un écart entre la diversité des miels mono- et polyfloraux réellement produits en Occitanie -région dans laquelle se situe l’étude- et celle que l’on retrouve à la table des français. Seuls quelques miels d’acacia, de châtaignier, de lavande ou « toutes fleurs » iconiques sont mis en avant par les lieux de distribution qui participent à stéréotyper les goûts et les couleurs des miels. Contrairement aux filières viticoles, oléicoles ou plus récemment brassicoles qui sont en pleine expansion, le consommateur identifie les miels via des critères restreints de couleurs, de textures et de saveurs. Ce phénomène d’appauvrissement des productions est principalement dû à la méconnaissance des qualités de miels ainsi que de son environnement géographique. L’image de l’abeille comme fleuron de la biodiversité et de la santé environnementale ainsi que le symbolisme porté à la couleur miel et aux produits de la ruche participent à la construction et à la promotion d’une image-territoire, une représentation collective de l’identité du terroir apicole façonnée par le sol, le climat, les hommes et les imaginaires. L’enjeu est alors de faire terroir apicole pour mettre en avant un secteur fédérateur et porteur d’innovations patrimoniales. Dans ce contexte, le design-couleur réenvisage les lieux du miel, entre collectes chromatiques et couleurs imaginées pour dessiner un nouveau colorama du miel.
Au-delà de son statut d’accessoire du peintre, la palette est aussi un outil de conception, un espace de représentation et de modélisation paradigmatique de la pensée coloristique et du design couleur et sensoriel, qui se révèle d’une grande versatilité applicative et recèle une capacité de transférabilité inter-champs. La palette senso-chromatique vise, à travers la caractérisation et l’ordonnancement des marqueurs sensoriels et chromatiques des bioressources locales et de leur « milieux de culture », à structurer une identité senso-chromatique de territoire alimentaire transférable et exploitable dans différents contextes et secteurs de valorisation et de production alimentaire. Partant d’une courte expérimentation collaborative autour du terroir Nord-Pas-de-Calaisien alliant conception de palettes et créations culinaires, cet article s’attache à mettre en perspective les modèles théoriques et pratiques d’une telle démarche, à en formuler les enjeux et à en envisager le potentiel d’application et d’innovation notamment pour la filière agro-alimentaire.
La cosmétique biologique certifiée se différencie de la cosmétique végane par la nature des matières premières qui la compose. Bien que le véganisme admette des ingrédients non naturels, le couple bio-végan forme un lexique associé à la représentation de la naturalité au sein de la société. Il en résulte une palette de vocabulaires et de couleurs spécifiques auquel s’ajoute la matière. Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une convention CIFRE. Le fard y est abordé comme matière-couleur à appliquer, à nommer et à formuler, en vue d’une production industrielle.
Les réserves publiées de pétrole et de gaz sont suffisantes pour saturer le budget carbone publié par le GIEC. Nous semblons être dans la perspective, soit d’un climat emballé faute d’arrêter l’extraction des produits carbonés à temps, soit de pertes aux conséquences économiques guère prévisibles dues à l’échouage considérable d’actif carbonés, qu’une réglementation devenue existentielle contraindrait. Pour y faire face, le présent article propose de mettre en place au plus vite une procédure comptable au sein des entreprises alimentant la chaine énergétique carbonée. Elle consiste en une provision prévoyant le remplacement des actifs consacrés au énergies carbonées. Financée dès sa mise en place, elle assurera la décarbonation des décisions d’investissement, en amont. Au sein des comptes annuels des industries productrices de pétrole, de gaz et de charbon, la nécessité de remplacer les actifs associés aux énergies dépendantes du carbone d’origine fossile sera ainsi actée en son coeur. Invitant la fourniture en temps opportun du capital nécessaire pour éviter l’échouage, la provision sera calculée selon une valeur comptable énergétiquement équitable des actifs ainsi destinés à être remplacés… à temps. Dans un contexte où les technologies d’énergies propres sont avides de financement, où le système de quota d’émission donne manifestement des signaux insuffisants aux investisseurs, mais où des précédents d’investissement sont malgré tout inspirants, on aborde les éléments clefs visés par notre procédure, dont son efficacité en capacité convertie, comblant - à temps ? - le besoin en énergies propres, son attractivité pour les investisseurs… et la disponibilité financière. Il faudra en dessiner la feuille de route avec la participation de gouvernances internationales juridiques et financières dont nous justifions la liste.
Cet article propose d’explorer la décarbonation comme catalyseur de la transformation industrielle, en examinant les tensions entre la nécessité de réindustrialiser les territoires et la prise en compte des enjeux environnementaux. À travers l’exemple de la reconversion du site de Renault à Flins, dans le département des Yvelines, en usine d’économie circulaire, il met en lumière les défis et les opportunités liés à cette évolution, tout en soulignant l’importance de comprendre les mécanismes complexes qui régissent les interactions dans ce nouvel écosystème.
L’objectif de ce chapitre est de questionner si le Serious Game correspond à une invention humaine. Pour répondre à une telle interrogation, nous proposons de vérifier si du jeu sérieux peut être recensée dans le règne animal. Si un tel recensement s’avérait négatif, alors nous serions en mesure d’en conclure que le Serious Game pourrait effectivement correspondre à une invention humaine. Dans le cas contraire, le jeu sérieux serait plutôt à considérer comme une activité (Serious Play) inter-espèce. Cela nous conduirait alors à étudier s’il est possible de dégager des aspects communs et des spécificités selon les espèces. Si en parallèle, il est possible de recenser des animaux faisaient également usage d’objets pour jouer à des fins utilitaires, alors nous pourrions voir le Serious Game non pas comme une invention mais plutôt comme faisant l’objet d’innovations chez l’Homme. Pour conduire cette étude, nous mènerons une analyse hypothéticodéductive croisant des lectures issues de l’éthologie, de la biologie et des sciences humaines.
Ce texte explore l’usage des jeux sérieux comme méthodes provocatrices en recherche. A partir d’une étude de cas détaillée de recherche par le jeu, les auteurs montrent comment le chercheur devient un agent provocateur qui influence les dynamiques étudiées, révélant des comportements autrement inaccessibles via des méthodes traditionnelles. Cette approche interdisciplinaire enrichit la recherche mais pose des défis en termes de validation des méthodes. Les jeux sérieux nécessitent des compétences variées et soulèvent d’importantes questions éthiques, notamment en ce qui concerne la protection des participants. En définitive, ils transforment la pratique de la recherche, favorisant une exploration plus créative et engagée des phénomènes sociaux.
Les jeux agiles forment une catégorie de jeux sérieux particulière, par leur spécificité d’être, historiquement et avant tout, associés aux méthodes dites agiles. Ces méthodes sont apparues durant les années 1990 et se sont structurées autour d’un manifeste au début des années 2000. À l’origine ces méthodes étaient essentiellement destinées à mieux gérer des équipes de conception et de développement informatique. Depuis, leur champ d’application s’est étendu à la gestion de presque tous les types de projets et organisations. Le succès de certaines de leurs mises en application a rendu le qualificatif agile tendance, ce qui a mené à une surexploitation de ce dernier, comme élément de langage, pour qualifier une entreprise de compétitive ou d’innovante. Après une brève présentation de ces méthodes, nous abordons dans ce texte, ces jeux agiles qui ont été élaborés pour les promouvoir ou accompagner certaines étapes de leur mise en oeuvre. Nous en dresserons une cartographie de ces jeux qui a été réalisée à partir d’une collecte de données issue de cinq sites Web et d’un livre qui leur sont dédiés. Nous estimons à partir de cette collecte, la variété et de l’utilité de ces jeux. De fait, nous présentons différentes sous-catégories de ces jeux en les qualifiant, et en décrivant les plus populaires parmi les sources interrogées.
La cybersécurité est l’une des professions en pleine expansion, nécessitant un nombre croissant de décideurs compétents. Le besoin de prendre des décisions adéquates ne se limite pas seulement aux spécialistes des technologies de l’information et de la communication (TIC), mais relève également largement de la responsabilité de la direction. L’une des méthodes pour améliorer la prise de décision est de s’exercer à travers des jeux sérieux basés sur des scénarios offrant une révision de la préparation avant qu’une crise ne se matérialise. Le champ de décision change également avec l’arrivée de nouveaux acteurs : des groupes motivés politiquement, financièrement et psychologiquement ciblant les actifs cybernétiques. Les jeux sérieux traitent souvent la sécurité en termes rouge (offensif) et bleu (défensif). Ce chapitre cartographie les différences potentielles qui apparaissent lorsque le profil de l’acteur menaçant est présenté en plus du scénario, permettant ainsi d’adapter les plans de réponse des hôpitaux à la menace spécifique. En conséquence, deux scénarios contrastés sont présentés, générant un plan de réponse pour un groupe de pirates informatiques motivé géopolitiquement et un hacktiviste motivé idéologiquement. Cette approche pourrait être davantage appliquée à la préparation cybernétique dans les hôpitaux, en utilisant le processus décrit dans cette étude.
La capacité d’un système informatique à analyser sémantiquement des textes passe notamment par l’interprétation de contenus de sens figuré. L’analogie est souvent utilisée afin de transmettre des idées nouvelles par similitude avec des idées connues. Il est possible de modéliser la comparaison et la métaphore sous la forme d’un carré analogique A : B : : C : D (signifiant A est à B ce que C est à D) avec une ou plusieurs variables dont il faut trouver les valeurs les plus pertinentes. Cet article présente deux jeux permettant de collecter des données lexicales en rapport avec les analogies. Le premier jeu, Analogia, est une adaptation de JeuxDeMots aux analogies, où le joueur doit fournir les réponses les plus pertinentes pour une analogie à une variable. Par exemple, trouver x pour "charbon est à noir ce que neige est à x". Le second jeu, Intersector, permet d’indiquer, en répondant à des questions, pour les 4 termes donnés d’une analogie, quels sont leurs points communs. Les termes proposés sont ceux issus des analogies du jeu Analogia. L’ensemble des données récoltées par ces jeux permet d’envisager une résolution automatique d’analogies, et donc l’interprétation de contenus figurés.
L’importance stratégique de l’information dans la compétitivité d’un pays et la gestion d’entreprise. Dans la société du savoir, l’information économique, qui diffère des autres biens, est cruciale pour l’avantage concurrentiel. Les entreprises qui accèdent aux informations pertinentes (marchés, juridiques, technologiques, etc.) avant les autres peuvent prendre des décisions stratégiques plus éclairées. Avec l’augmentation massive des données disponibles, l’intelligence économique devient essentielle pour filtrer et organiser ces informations. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les processus d’entreprise nécessite une approche méthodique, incluant le développement de solutions d’IA personnalisées, leur intégration avec les systèmes existants, et leur utilisation pour améliorer ou créer des services innovants qui améliorent l’expérience client.
Cet article fait état du travail de recherche conduit au cours de mon doctorat « La couleur dans l’environnement visuel : perception(s), lecture(s), interprétation(s) et impact(s) sur l’usager âgé. De l’approche de l’ingénieur lumière (science et technologies des systèmes d’éclairage) et du designer-coloriste (arts-appliqués, design) ». Partant du postulat que maintenir la capacité des personnes âgées à conduire leurs activités quotidiennes est un levier majeur pour prendre soin de leur qualité de vie, j’ai développé une nouvelle méthode conception combinant design-couleur et science de l’éclairage, dessinant les prémices d’une stratégie non-médicamenteuse conduisant à la conception d’environnement adaptés aux besoins de l’usager âgé présentant des troubles visuels, dans un premier temps. Cette démarche systémique est ainsi moteur d’une innovation sociale en rupture avec les modalités actuelles du prendre soin.
En raison des récentes pandémies, la majorité des organisations ont dû expérimenter le travail à distance à des degrés divers et ont reconnu la productivité exceptionnelle des salariés dans ces conditions particulières. Malgré ce bilan positif, et en dépit des aspirations des salariés, les entreprises les plus innovantes plaident de manière autoritaire pour un retour à plus de présentiel, car il serait le seul mode d‟organisation du travail à même de produire la collaboration nécessaire à l‟efficacité des équipes innovantes. Dans cet article, nous montrons que cet argument du retour au bureau se base sur une conception étroite qui fait de la confiance produite par le présentiel, ou confiance affective, le principal moteur de la dynamique collaborative. En s‟appuyant sur les Trust Studies et des travaux en management de l‟innovation, nous soulignons, au contraire, que la distance ne limite pas la production d‟une confiance efficace et adaptée aux exigences des équipes innovantes. Nous allons même plus loin en proposant une articulation inédite entre deux formes de confiance, la swift trust et la confiance réflexive, à travers une confiance réflexive rapide, pour soutenir un nouveau mode de travail hybride favorisant la collaboration et l‟innovation.
Le programme Red Team Défense de l’armée française consiste à créer des récits de science-fiction dans le but d’anticiper les conflits qui pourraient menacer le territoire à horizon 2030-2060. S’inscrivant dans le courant de la science-fiction institutionnelle, il repose sur la capacité à susciter l’estrangement cognitif cher à Darko Suvin et à créer des novums (technologies imaginaires) vecteurs de difficultés, mais aussi de solutions aux problèmes recontrés dans les guerres du futur. Si certains novums ont une fonction performative, la diégèse, c’est-à-dire l’environnement spatiotemporel du récit, revêt davantage une dimension dysperformative. Ces histoires cherchent à susciter la réaction des militaires face à des dangers imaginaires afin qu’ils mettent en oeuvre en amont des stratégies permettant d’éviter leur réalisation. Les auteurs de science-fiction captent l’inconscient des organisations et révèlent leurs imaginaires prophétiques. L’innovisme est par ailleurs une véritable idéologie utilisant pragmatiquement l’imaginaire pour remettre en question l’ordre établi et générer de nouvelles idées sources de destruction créatrice. La Red Team fait par ailleurs entrer l’armée française dans un régime d’historicité orienté vers le futur, plus que vers les batailles du passé. La science-fiction est aussi un genre paradoxal, impliquant une interprétation spécifique du réel et de l’avenir. Il convient donc de s’interroger sur les avantages et éventuels désagréments liés à l’utilisation d’une vision paradoxale du futur dans l’élaboration des stratégies d’une organisation visant avant tout l’efficacité et le pragmatisme.
Dans la lumière des apports des logiques de l’Intelligence Artificielle (l’IA) et des problématiques de recherche sur les solutions de qualification participative des données d’impact rappelant des interrogations et analyses plus anciennes dont le paradoxe de Condorcet [CON 85] et la théorème de l’incomplétude d’Arrow [ARR 51] ou du Prix Nobel Amartya Sen [SEN 70] sur les évolutions des modèles économiques vers une économie du bien-être avec le choix collectif nous proposons des réponses possibles de co-construction des nouveaux outils et processus hautement collaboratifs de qualification ouverte [PAU 12]. En prenant en compte la diversité des acteurs de l’innovation ouverte pour intégrer les capabilités augmentées par l’IA nous arrivons à intégrer ex ante dans les processus hautement démocratiques et des outils IA la diversité des déterminants évolutifs des avis sur les impacts perçus sur tout sujets d’intérêt commun exprimés. Cela conduit nos recherches vers la découverte [PAU 22] d’une troisième typologie d’IA en plus de celle symbolique et celle connexionniste-connective : l’Intelligence Qualificative (QuAI) - avec la capabilité d’intégrer l’esprit critique humain. Les nouveaux espaces – les outils QuAI, les processus de qualification ouverte collaboratifs - peuvent ainsi mener à des choix optimaux par la collaboration et la création collective de pertinence et confiance notamment par les nouvelles capabilités dynamiques créatrices potentielles d’innovations disruptives. Plusieurs fonctionnalités d’usages sont identifiées en termes d’évolutions vers une économie de la fonctionnalité [VAI, 20]. et la démocratisation de l’accès et de la contribution aux données d’impacts visant des solutions et outils innovants disruptifs de résilience [SCH 22] face aux crises multiformes : économiques, climatiques, de confiance [PAU 09, 12, 18], [ADA, 18].
Le développement du numérique est mis en avant comme solution aux enjeux économiques et environnementaux de l’agriculture, alors que ses effets font l’objet de controverses. Cet article cherche à montrer comment le développement du numérique dans le secteur agricole impacte et s’intègre dans les différents modèles agricoles. Pour cela, il propose une approche en économie institutionnelle et multi-niveaux des systèmes d’innovation, mise en oeuvre à travers une méthodologie associant analyses quantitatives et qualitatives. À l’échelle des organisations du système d’innovation agricole, selon que les acteurs se rattachent à l’agriculture biologique ou conventionnelle, les attentes et risques perçus, ainsi que les stratégies de digitalisation, sont différents. Ces différences sont toutefois peu perçues par les acteurs du numérique. A l’échelle des exploitations agricoles, à partir de 98 entretiens avec des agriculteurs, des profils d’usage du numérique sont construits. Dans l’ensemble, les usages du numérique dans les exploitations accompagnent plutôt des stratégies d’écologisation faible, ou symbolique, associées à une trajectoire d’industrialisation, caractérisée par la spécialisation, la concentration, le recours croissant au salariat et à la sous-traitance et l’intégration dans les chaînes de valeur agrialimentaires. Ce travail met en évidence que les perceptions et usages du numérique diffèrent selon les modèles agricoles auxquels les acteurs se rattachent. La digitalisation n’apparaît pas comme la résultante de comportements dits « pionniers » mais dépend de la diversité des modèles et paradigmes, en interaction avec un système socioéconomique qui propose, incite, voire impose ces technologies. La digitalisation actuelle montre plusieurs formes d’oppositions vis-à-vis de la transition agroécologique, que ce soit en termes techniques, d’objectif, de raisonnement, de dynamique temporelle mais aussi d’enjeux politiques et sociaux. Des hybridations semblent toutefois possibles dans le cas de formes d’écologisation industrielle, mais aussi à travers une transformation plus globale de la digitalisation elle-même en repensant ses modèles techniques, économiques et politiques.
La pratique professionnelle ou semi-professionnelle des wargames est appelée wargaming. Elle comprend de nombreuses formes de simulations de guerre qui ont en commun d’être des jeux sérieux fondés sur des données issues du terrain et/ou visant à en collecter de nouvelles. Leur usage peut être à visée pédagogique, préparatoire à la mise en oeuvre d’un plan, exploratoire ou prospectiviste. Le wargame se joue sur un support physique ou informatique, voire via une forme hybride entre ces deux alternatives. À partir d’un parcours de la littérature consacrée à ce sujet, cet article propose d’éclairer le lecteur sur les différentes catégories de wargames pratiquées par les militaires, ainsi que sur les avantages, inconvénients et risques d’emplois de wargames physiques vis-à-vis des numériques.
Cette contribution interroge les dynamiques à l’oeuvre au sein des industries aérospatiales et de défense (A&D) en identifiant les principaux facteurs agissant sur l’innovation. A partir du modèle développé par [BAR 19] et [BAR 20], la recherche examine la dynamique des innovations de défense intégrant des composants issus de la recherche en Intelligence Artificielle (IA). Considérée comme une technologie d’application générale (General Purpose Technology, GPT ; [BRE 96]), l’IA et ses multiples applications affectent en effet significativement les capacités militaires actuelles et futures et constitue un matériau empirique pertinent si l’on cherche à comprendre comment opère l’innovation dans les industries A&D.
Le New Space désigne l’émergence d’un système économique du secteur spatial dans lequel de plus en plus d’acteurs privés sont appelés à participer. La science-fiction propose depuis quelques années des représentations des entreprises du capitalisme spatial. Cet article en étudie certaines, comme les films Space Sweepers, Venom, ou la série Salvation et montre que la figure du milliardaire du New Space suscite à la fois de la fascination et du rejet. Si ces fictions s’inspirent de personnages réels comme Elon Musk, elles influencent aussi le grand public et les acteurs du secteur spatial. Ces récits sont au centre d’enjeux stratégiques et de soft power. Il est suggéré que l’Europe se dote d’un système de création d’histoires de science-fiction spatiale performant et performatif afin d’optimiser la créativité de ses futurs entrepreneurs. En effet, ces récits proposent souvent une réflexion sur l’éthique de la conquête spatiale et imaginent des technologies qui pourraient devenir des innovations majeures à l’avenir.
Après une première longue phase de développement gouvernemental et scientifique, le secteur spatial a été secoué par de nouvelles approches au cours des années 2000, regroupées sous le terme générique de « New Space ». À travers l’étude des évolutions de cet écosystème, ce travail académique propose une caractérisation du New Space, considéré comme un ensemble de ruptures composées de nouveaux entrants, de nouvelles applications, de nouvelles technologies, de nouvelles réglementations, de nouveaux procédés et de nouveaux modes de financements. Mais, au-delà, il souligne que ces ruptures se nourrissent de leur interaction et leur interdépendance. Enfin, cette richesse du New Space nous amène à identifier les nombreuses implications pour les sciences économiques et managériales, à la fois en termes de programmes de recherches ou d’enseignement.
La multiplication des litiges en matière de brevets est révélatrice de la tension qui existe entre, d’une part, la nécessité d’assurer l’interopérabilité et la compatibilité entre les composants d’un produit et, d’autre part, le respect des droits de propriété intellectuelle (PI). Dans cet article, nous montrons que cette tension n’est pas nouvelle. Les « guerres » de brevets sont historiquement associées à des innovations de rupture et témoignent de l’importance croissante des modèles économiques fondés sur la valorisation de la PI. Tout en reconnaissant les effets parfois délétères de la dynamique contentieuse, on peut considérer que les litiges sont un moyen d’ajuster ex-post l’étendue de droits conférés par la PI.
Malgré leurs atouts, les PME apparaissent comme un potentiel d’innovation insuffisamment exploité. Cela est d’autant plus vrai en période de crise. Dans un contexte caractérisé par trois sources de déstabilisation (développement d’une économie de plateforme, crise sanitaire COVID-19 et tensions sur les marchés) cet article a pour objectif de proposer des pistes pour favoriser la capacité d’innovation des PME. Après avoir rappelé les principaux freins des PME en matière d’innovation – qui tiennent majoritairement à un accès limité aux ressources –, et leur principale force – qui s’explique surtout par leur structure organisationnelle –, nous envisageons comment ces mutations challengent la capacité à innover des PME. Les pistes et axes de recherche qui en découlent conduisent notamment à déplacer le curseur : du dirigeant de la PME vers ses équipes et d’une innovation collaborative externe vers une innovation collaborative interne.
Cette étude multi-cas analyse le rôle des facteurs organisationnels influençant la résilience de l’industrie 5.0 au cours des premières phases de la pandémie de Covid-19 en France. Le cadre 7S de McKinsey est utilisé pour comprendre comment huit petites et moyennes entreprises françaises appartenant à l’alliance "Industrie du Futur" ont adapté leur stratégie, structure, systèmes, compétences, personnel, vision et style de management tout en s’appuyant sur leurs valeurs communes pour développer une forme d’agilité organisationnelle et résilience. Nos résultats confirment que, même si les systèmes technologiques ont été un élément clé de leur réponse à la situation de Covid-19, les éléments humains ont également joué un rôle central dans leur capacité à faire face à la crise. Nos recherches ont également mis en lumière l’importance des réseaux de parties prenantes dans la capacité d’une organisation à s’adapter et à prospérer pendant les crises. Le cadre qui en résulte pourrait aider les entreprises à développer une approche de l’agilité et de la résilience centrée sur l’humain.
L’objectif de cet article est de proposer une réflexion autour du concept de milieu éco-innovateur pour analyser la dynamique du développement territorial durable. Il s’agit d’une approche basée sur la théorie européenne des milieux innovateurs mais visant à intégrer la question environnementale dans l’analyse des réseaux territoriaux d’innovation. Nous considérons que les symbioses industrielles, dans lesquelles un collectif d’acteurs territoriaux sont liés par des relations de valorisation des flux de matières et de déchets, peuvent prendre la forme d’un milieu éco-innovateur. Ces relations peuvent être à l’origine de l’émergence de nouvelles dynamiques d’innovation à travers l’apprentissage collectif qui résulte de la gestion commune des ressources du territoire (adoption de nouvelles pratiques éco-responsables, développement de nouvelles technologies durables, renforcement de la communication et de l’échange de connaissances autour de ces nouvelles pratiques...). Nous illustrons notre raisonnement par un exemple d’application au territoire industriel de Dunkerque, France.
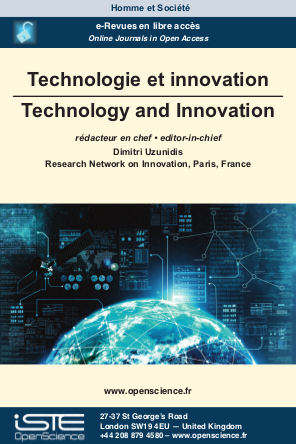
2024
Volume 24- 9
Les filières de production dans la bioéconomie2023
Volume 23- 8
Intelligence artificielle et Cybersécurité2022
Volume 22- 7
Trajectoires d’innovations et d’innovateurs2021
Volume 21- 6
L’innovation collaborative2020
Volume 20- 5
Les systèmes produit-service2019
Volume 19- 4
L’innovation agile2018
Volume 18- 3
Analyse systémique et petites entreprises innovantes2017
Volume 17- 2
Techno-économie des risques industriels2016
Volume 16- 1
Stimulateurs de l’entrepreneuriat innovant