

Physique > Accueil > Entropie : thermodynamique – énergie – environnement – économie > Numéro
Dans cet article, après avoir rappelé la définition actuelle du terme « chaleur » on résume son évolution en se focalisant sur le mode de la conduction thermique. La notion de chaleur a été discutée dès l’antiquité que ce soit en Orient ou en Occident. D’abord basée sur les sensations de chaud et de froid la notion de chaleur a longtemps été confondue avec celle de température. Deux types de théories se sont développées parallèlement, les théories substantialistes et les théories mécanistes. Nous suivons la progression de ces deux types de théories depuis l’antiquité pour arriver aux théories actuelles. A l’origine étaient les catégorisations aristotéliciennes, puis on cite la théorie du phlogistique, celles du calorique et de l’éther pour lesquelles la chaleur est une substance mais on montre que dès l’antiquité le mouvement des corpuscules matériels a été également associé à la chaleur. Néanmoins, de nombreux chercheurs de la fin du 18ème siècle et du début du 19ème n’ont pas voulu prendre partie, comme Fourier, qui a formalisé la conduction dans son travail de pionnier et qui reste la référence. L’interprétation corpusculaire est désormais reconnue et a suivi l’évolution du reste de la physique avec l’apparition de la mécanique quantique. La conduction thermique a été ainsi associée aux interactions entre les particules ainsi qu’aux vibrations atomiques dans les solides. Dans ce contexte, l’introduction de la quasi-particule phonon a permis une grande partie des développements actuels.
Dans la recherche sur l’origine de la vie, on identifie d’abord des thèmes qui peuvent être considérés comme raisonnablement partagés par la généralité des chercheurs. L’application de ces principes aux résultats obtenus avec le modèle mathématique de simulation des processus agrégatifs développé par les auteurs (et objet de publications anté-rieures) conduit à la conclusion que la formation primordiale de structures autoréplicatives est difficile à concilier avec la dynamique agrégative déterministe au sens classique du terme. Quoi que ce soit la mesure dans laquelle le processus est gouverné par le hasard ou par des codes agrégatifs écrits dans les lois de la chimie, aucune causalité conventionnelle n’est probable. En effet, lorsque le modèle est appliqué à la simulation de processus agrégatifs en l’absence d’éléments direc-teurs (c’est-à-dire des agents porteurs de codes, également capables de favoriser les effets catalytiques), comme cela a probablement été le cas dans le monde prébiotique, la formation répétitive et ordonnée de structures suffisamment com-plexes implique un déficit d’entropie difficile à justifier dans un contexte classique. Une seule issue semble possible : l’exis-tence d’ensembles d’informations affectant l’évolution du système selon des modalités différent de ceux qui se réfèrent à l’écoulement du temps perçu. Les possibilités offertes par la mécanique quantique et ses interprétations les plus récentes sont donc explorées pour tenter de clarifier, au niveau de la physique des particules, cette conjecture énigmatique et non conventionnelle.
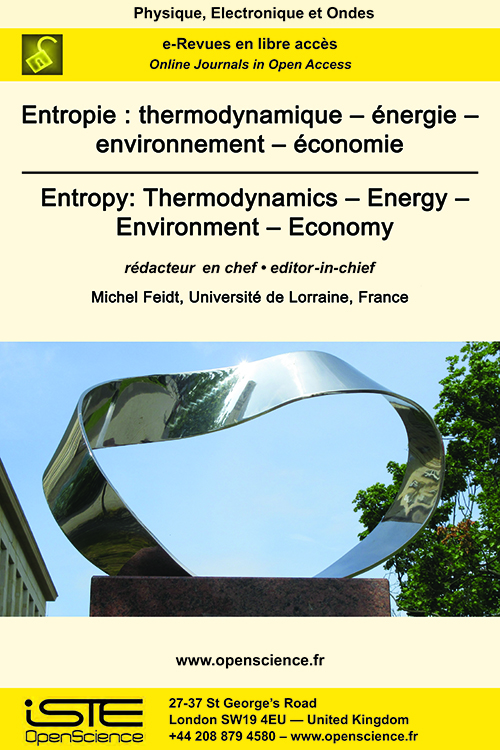
2026
Volume 26- 7
Numéro 12025
Volume 25- 6
Numéro 12024
Volume 24- 5
Numéro spécial IEES2023
Volume 23- 4
Numéro 12022
Volume 22- 3
Numéro 12021
Volume 21- 2
Numéro 2 spécial SFT Prix Fourier2020
Volume 20- 1
Numéro 1